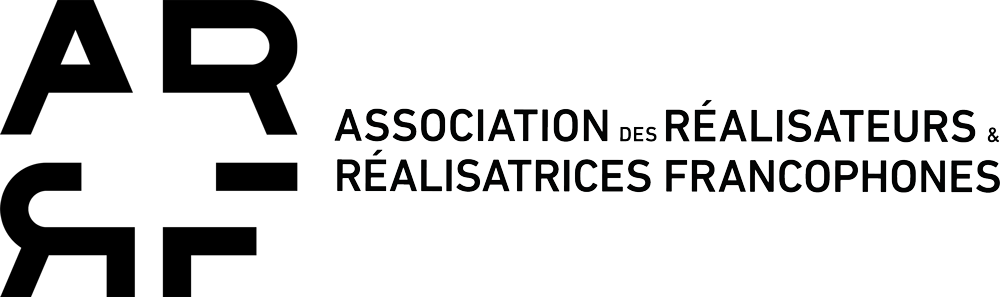Le décret sur les Services de Médias Audiovisuel (“décret SMA”), adopté en février 2021, transpose en droit belge une directive européenne de 2018. Ce nouveau cadre réglementaire a pour objectif d’imposer aux éditeurs locaux et étrangers de contribuer plus fortement à la production audiovisuelle en FWB – un taux de contribution de 2,2% du chiffre d’affaires réalisé en FWB doit être investi dans la production locale.
Suite à une réforme du décret SMA en 2023 – entrée en vigueur au 1er janvier 2024 – le taux de contribution est passé de 2,2% à 9,5% à l’horizon 2027, ce qui devait permettre d’injecter 12 à 16 millions d’euros supplémentaires dans la production audiovisuelle belge francophone. Les pourcentages de contribution, dont une partie doit être affectée selon des critères culturels, sont calculés sur le chiffre d’affaires des éditeurs de services de médias linéaires et non linéaires.
Ils progressent en fonction du chiffre d’affaires annuel, et dans le temps avec une montée en charge entre 2023 et 2027, afin de permettre au secteur de convenir de projets nouveaux. Les pourcentages de contribution prévus par le décret SMA révisé sont, à titre de comparaison, nettement inférieurs à ceux appliqués dans le cadre de la transposition en droit français.
En septembre 2024, Netflix – bientôt suivi par Disney – a introduit un recours contre le décret SMA devant la Cour constitutionnelle. Dans son recours, Netflix reproche à la législation belge francophone:
1) D’avoir un but économique et non culturel ;
2) De prévoir des taux de contribution plus élevés que dans les pays voisins « de même taille » ;
3) D’imposer des sous-quotas de financement trop détaillés alors que les talents manqueraient en FWB pour absorber ces investissements obligatoires ;
4) De porter atteinte à ses droits fondamentaux et notamment sa liberté d’entreprendre.
Le recours de Netflix fait partie d’une stratégie globale, très menaçante, des opérateurs globalisés pour réduire, et si possible supprimer, en s’attaquant d’abord aux petits États membres, toute politique de régulation, y compris fiscale, qui limiterait les effets de leur surpuissance dans les paysages audiovisuels européens. En effet, force est de constater que ce recours attaque en réalité le système de financement de l’audiovisuel mis en place tant par la directive européenne sur base de contributions d’éditeurs, que par les États membres ayant un système de financement de l’audiovisuel. Ce recours, s’il devait être jugé fondé par la Cour constitutionnelle ou par la Cour de justice de l’Union européenne, menace tant le développement d’une production indépendante européenne que les politiques de diversité culturelle de l’audiovisuel.